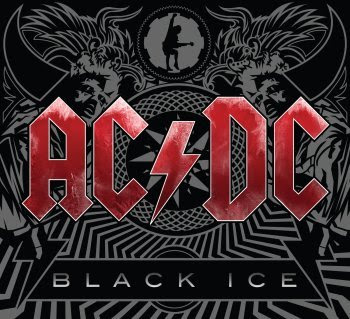Lundi 20 octobre, 9h30, sur les Champs-Élysées.
Votre serviteur et le fils (spirituel) du borgne Snake Plissken (John, venu spécialement de la quatrième planète du système solaire) se rendent, le cœur battant, à l’unique avant-première réservée à la presse du dernier James Bond. Après une fouille au corps et quelques attouchements du service d’ordre (avec toucher rectal pour les équipes de Ciné Live et Studio Magazine), on accède enfin à la grande salle prestige de l’UGC Normandie, parés pour un boost d’adrénaline…
La projection démarre avec une demi-heure de retard, du fait de la parano du distributeur qui voit en chaque journaliste un pirate potentiel (appareils photo, téléphones et ordinateurs portables sont confisqués à l’entrée du cinéma, équipé pour l’occasion de portiques de sécurité dignes d’un aéroport). Rien de mieux pour se plonger dans le monde du contre-espionnage que ce barnum à la Big Brother. Un cirque qui fait peut-être partie du plan média de Sony.
Première déception : Quantum of Solace - qui n’a de commun avec Ian Fleming que le titre de l’une de ses nouvelles - ne dure que 1h47. Ce qui en fait le Bond le plus court depuis Goldfinger en… 1964 !
Mais chut, la lumière s’éteint. Et le plaisir des retrouvailles avec Bond est à son comble.
FILM DE TRANSITION
Quantum…, qui s’inscrit directement dans la suite de Casino Royale, démarre exactement là où se terminait l’épisode précédent. Une première dans l’histoire de la saga. On s’excusera donc d’avance de faire comme si tout le monde avait vu le film (sinon comment étayer des arguments sans révéler certains points de l’histoire ?). Si vous redoutez les spoilers, merci donc de ne pas lire ce qui suit…
La poursuite automobile qui ouvre le film est nerveuse et percutante. A bord d’une Aston Martin, 007 se fait courser par des vilains en Alfa Romeo le long d’une corniche. Daniel Craig, habillé par le célèbre couturier Tom Ford, conduit sa caisse comme une Batmobile. Les bagnoles se crashent violemment contre des 15 tonnes et tombent d’une falaise. Whaaaaa ! Le décor est bien planté pour une belle histoire d’espion vengeur.
La meilleure scène d’action de ce Bond - mais aussi la plus spectaculaire - est placée juste après ce générique. Notre agent secret se lance à la poursuite d’un tueur sur les toits de Sienne, puis traverse l’arène du Palio, où se déroule chaque année une célèbre course de chevaux. L’affrontement se conclu dans une tour florentine en rénovation. Passant au travers d’une vitre en image de synthèse, Bond rebondit sur un échafaudage avant de se balancer dans le vide le long d’une corde !
Car après cet appetizer, on rentre de plein pied dans l’intrigue du film. Et les problèmes apparaissent…
Il faut savoir que l’un des principaux scénaristes du film, Paul Haggis**, s’est totalement désolidarisé du projet, en se mettant en grève après un sérieux clash avec la production. Quand le tournage débute, un tiers du script n’est toujours pas écrit, alors que la date de sortie, elle, est déjà fixée par le distributeur. Ca se ressent beaucoup pendant la vision du film, tant ce pauvre Daniel Craig semble largué au fil du récit, naviguant à vue et passant d’un pays à l’autre sans aucune espèce de logique.
D’habitude, 007 accomplit la mission qu’on lui assigne, alors que cet épisode est construit autour de la vengeance personnelle de Bond (comme dans Permis de tuer, tiens). Notre agent cherche en effet à régler ses comptes avec l’organisation criminelle qui a provoqué la mort de Vesper Lynd, sa maîtresse traîtresse noyée dans les ruines d’un palais vénitien à la fin de Casino Royale.
Très bien. Mais alors pourquoi ce 22ème volet déconne-t-il autant ?
Craig est irréprochable. Le comédien britannique se donne à 100 % et assure dans un rôle très physique. On peut néanmoins tiquer sur l’évolution de son personnage. Dans Casino Royale, le Bond blond passait par tous les stades émotionnels (amour, souffrance, haine). Ici, il n’est plus qu’une machine à tuer qui, tel un bulldozer, détruit tout sur son passage, arrachant les poignées de porte à pleine main avec une facilité déconcertante.
Pire : ce 007 n’a pas une once d’humour. Il ne décroche la mâchoire que pour lancer quelques vannes bien senties à ses adversaires (elles sont écrites par une armée de punchliners). Mais ces répliques, trop mécaniques, manquent vraiment de naturel. Décoince James…
Le plus drôle, c’est peut-être cette manie qu’ont les producteurs de transformer Bond en homme-sandwich. Publicité vivante pour des voitures de sport, des marques de champagne, des montres de luxe et autres produits bling-bling… Vous me direz qu’il n’y a rien de nouveau dans cette démarche. Sauf que le placement de produit représente ici 63 millions d’euros ! Soit 35 % du budget du film (estimé à 230 millions de dollars, record absolu pour un James Bond). On subit donc ici, jusqu’à l’indigestion, des pubs subliminales pour Ford, Coca Zéro (devenu OO !), la bière Heineken, Sony Ericsson, Swatch et consorts. My name is “product placement” ?
RESTONS CALMES
Les autres personnages du film n’ont pas plus bénéficié d’un traitement de faveur. A commencer par le méchant en chef, Dominic Green, joué de manière grotesque par l’avorton Mathieu Amalric (il s’est inspiré du regard de Nicolas Sarkozy pour son personnage). Acteur fétiche du pénible Arnaud Depleschin, Amalric n’est vraiment pas à sa place dans l’univers bondien. Le félon fait les gros yeux mais provoque davantage le rire que la crainte.
Pour jouer un vilain français, Amalric aurait dû demander conseil au suave Michael Lonsdale sur le tournage de Munich de Steven Spielberg (où Daniel Craig trimballait aussi sa carcasse). Le Hugo Drax de Moonraker se serait fait un plaisir de lui expliquer comment se comporter en authentique salaud mégalomaniaque.
La James Bond girl Olga Kurylenko relève un peu le niveau. Cette bombe ukrainienne, devenue depuis la compagne du réalisateur Marc Forster (ben voyons - NDJP), accompagne ici le hitman originel dans ses aventures. Ayant baisé avec le méchant, Bond n’y touchera pas, effleurant seulement ses lèvres lors d’un timide baiser final. Camille - c’est le nom de son personnage - est une femme au passé tragique. Toute sa famille a été tuée sous ses yeux quand elle était enfant (elle le répète deux fois pour ceux qui somnolent au fond de la salle).
Sinon, tout le monde tire la gueule dans cet épisode. De M la momie (Judi Dench) qui habite dans un HLM tout pourri de la banlieue londonienne (à croire que le M16 la paie au lance-pierre) à Felix Leiter (Jeffrey Wright), célèbre agent de la CIA et ami de Bond, qui n’a rien à faire que bouder dans son coin.
Bien avant cette bérézina, on avait pourtant assisté à une scène impressionnante à l’Opéra de Bregenz en Autriche. Un amphithéâtre de 7000 spectateurs où Bond s’énerve contre des portes flingues à oreillettes. Là, il se passe vraiment quelque chose, des frissons remontent de la mémoire cinéphile (on pense au final de L’homme qui en savait trop ou à celui du Parrain 3). En une scène, le film se glace.
Pour le reste, les scènes d’action tombent systématiquement tous les quarts d’heure, mais on ne s’implique jamais émotionnellement. Ou si peu. Prenez le moment où Bond et Camille tombent en chute libre depuis un DC-3. Après avoir assisté à l’une des poursuites en avion les plus soporifiques de l’histoire du cinéma, on est à peine surpris quand le couple atterrit, pile, dans le cratère où Green a établi son barrage.
A la fin, Bond s’infiltre dans le repaire du méchant et fait tout sauter (zzzzzzz…). Au milieu des flammes de l’enfer, Craig affronte Amalric qu’il laissera crever en plein désert. Avec tout de même un jerrican de pétrole pour abreuver sa soif (il n’a pas supporté de voir Gemma Arterton transformée en flaque de goudron sur son pieu).
La grande question, c’est de savoir si ce nanar surproduit va dépasser les 594 millions de dollars de recettes mondiales générées par Casino Royale ? Lors du générique de fin, un panneau nous indique que Bond reviendra. On n’est pas trop pressé de revoir sa gueule (bon ça suffit David, tu nous l'as bien viandé le Bond, je te remets la muselière - NDJP).
* Pour ceux qui auraient passé ces onze dernières années en expédition spéléo, il s’agit du leader du groupe de rock The White Stripes.
** Paul Haggis a signé le scénario de Million Dollar Baby et Casino Royale. Il a aussi réalisé Collision et Dans la vallée d’Elah.